WEB, LITTÉRATURE ET LIVRES ÉLECTRONIQUES :
entretien avec François Bon
il n’existe pas de prédicat “ceci est de la littérature”…

À plusieurs reprises dans vos textes, vous soulignez la force de l’écosystème de lecture. En tant qu’éditeur, en quoi l’environnement électronique a-t-il modifié notre rapport à la lecture ?
Je pratique les textes sur format numérique quasiment depuis que j’ai eu un ordinateur, en 1988. Mais c’était un rapport de travail. Avec l’arrivée des premières liseuses (pour moi, une Sony, en 2008), on pouvait lire avec le confort d’un livre des proses continues. Mais l’ergonomie ce n’était pas encore vraiment au point. Désormais, d’un côté parce qu’on sait faire des epubs confortables et stables (rendu à peu près équivalent quel que soit l’appareil de lecture) et parce que ces appareils ont évolué, on peut les oublier. On a ça dans la poche, on n’aurait plus l’idée d’aller acheter un journal ou un livre en papier. L’iPad est devenu le premier compagnon pour la lecture personnelle, mais depuis l’arrivée récente de l’Odyssey, de la Kobo, je me suis remis à lire sur liseuse. Ces appareils sont bien, parce que désormais on les oublie – c’est le livre papier qu’on trouve gênant, quand on est obligé d’en trimballer un, ou qu’on a le réflexe de cliquer sur un mot avec le doigt pour appeler le dictionnaire ou le moteur de recherche.
C’est encore à l’éditeur que je m’adresse. Vous vous opposez vigoureusement aux DRM. Ne craignez-vous pas qu’il risque d’arriver au livre édité numériquement ce qui est arrivé à la musique, à savoir un partage généralisé en accès gratuit via le P2P (ce que l’on appelle ordinairement “le piratage”) ?
Arrêtons avec le verbe “craindre”. Je crains de prendre l’escalier, donc je reste à l’étage. La question n’est pas de craindre le piratage, elle est de continuer à susciter pour la littérature contemporaine une appétence, une exigence. Quand nous employons la notion d’éco-système c’est ici : avec le web, nous rendons possible l’accès à l’atelier, donc à une vaste partie gratuite de nos travaux. Mais nous pouvons, avec le livre numérique – par exemple, pas le seul –, proposer un “service”, une commodité d’accès, qui peuvent inclure aussi les annotations partagées, les mises à jour, les œuvres en expansion qui rendent dissuasif ou inutile le peer to peer.

Liseuses électroniques. Photo: D.R.
Dans le cadre d’une philosophie de l’accès plutôt que de la possession, ne craignez-vous pas que l’accès aux livres – et donc au savoir, à la culture, à l’art – se trouve concentré entre les mains d’entreprises qui sont, quant à elles, bien physiques et qui peuvent disparaître du jour au lendemain, privant ainsi le lecteur d’un accès aux textes ?
On recommence avec le verbe “craindre” : j’ai peur de Nestlé, donc je n’achète pas de lait à mes gosses. Oui, nous affrontons un système de diffusion centralisé, dont la raison d’être n’est pas l’humanisme. C’est pareil aussi pour les marchandes de bagnoles. Mais on peut se dire, au contraire, qu’on les investit, qu’on utilise leurs outils non seulement pour autoriser l’accès à nos travaux, mais qu’on intervient pour leur promotion. C’est à ça qu’on s’emploie, et souvent en dialogue avec eux. Confusion dans la question : la pérennité d’accès n’a rien à voir. Le rôle des bibliothèques, avoir nos propres serveurs en complément ou parallèle de ceux des librairies numériques, même si mon ordi passe sous un camion, ou qu’Apple cesse demain la diffusion de livre numérique, qu’importe.
La garantie ne se trouverait-elle pas du côté des bibliothèques ? Ce qui voudrait dire que la bibliothèque devra, elle aussi, faire sa révolution numérique ?
Pourquoi utiliser le futur ? Heureusement qu’elles n’ont pas attendu l’onde de choc pour penser leur métier de façon numérique. Les tâches de médiation, d’orientation, la notion de service public dans l’accès (quand de grands campus comme Nice, Montpellier ou Strasbourg donnent accès intégral à Publie.net pour chaque étudiant connecté). Si le métier de bibliothécaire c’était seulement de classer, relier et prêter des livres, quel intérêt ?
Je m’adresse maintenant à l’écrivain. Dans un interview datant de 2006 pour Le Magazine Littéraire, vous écriviez : c’est étonnant comme le monde littéraire se défie du Net. Pensez-vous que ce soit toujours vrai ?
Ça me paraît d’évidence, en tout cas si je compare des professions artistiques comme les musiciens, ou des professions scientifiques (hors les facs de Lettres qui sont encore plus à la traîne) : les écrivains de l’imprimé ont largement tendance à ce syndrome de l’ours blanc, resté les griffes plantées dans le glaçon à la dérive, qui fond de toute part. Mais la donne a évidemment changé en 5 ans : les auteurs qui sont apparus, ont commencé de publier depuis lors, sont venus avec leurs usages numériques, leurs blogs, et eux savent très bien que si on veut savoir ce qui se passe, mieux vaut aller voir sur le web.
D’une certaine façon ne pourrait-on pas dire que le net “transpire” chez les écrivains d’aujourd’hui ? Je pense aux affaires récentes de plagiat ; les cas “Hegemann” en Allemagne et “Houellebecq” en France me semblent à ce titre emblématiques ?
Ces questions de plagiat ne sont que des marronniers à journaux en déconfiture. On écrit toujours avec ce qui a déjà été écrit.
Un de vos articles, repris dans votre dernier ouvrage, après le livre, s’intitule (écrire) que les commentaires ne sont pas une écriture du bas. C’est une très belle formule. Pensez-vous que les commentaires sont un enrichissement du texte, qui fait partie intégrante de ce dernier; autrement dit que l’écriture d’un article de blog est plus un processus qu’un acte définitif. Pensez-vous que nous revenons à une forme d’oralité dans l’écriture ?
L’histoire de la littérature, pas seulement la tradition juive (comme le Zohar) a toujours inclus son propre commentaire, ce que Blanchot nommait “l’entretien infini”. La différence, c’est que ce lire/écrire en un seul mot peut désormais se tenir sur le même support, être parfaitement symétrique dans les positions d’ailleurs, et intervenir dès l’amont de la publication, là où c’est le chantier même qu’on publie. On ne change pas l’instance collective de la littérature, là où elle n’est pas incompatible avec la “solitude essentielle” de l’auteur – je pense aux conversations rapportées par Kafka, aux 3000 lettres laissées par Beckett, mais cette instance collective peut sortir de la sphère privée, ne pas avoir à attendre la publication comme hiérarchie.
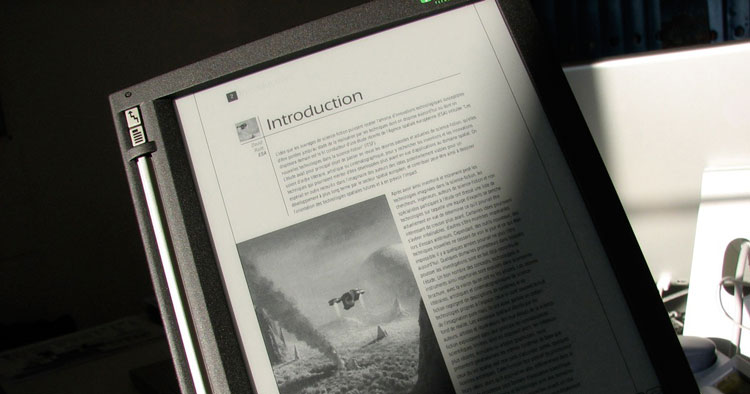
Liseuses électroniques. Photo: D.R.
Je m’adresse enfin à l’éditeur et à l’écrivain. Je commence avec une question qui vous a été posée plusieurs fois, mais je n’y résiste pas : pensez-vous que la notion d’auteur a évolué sous l’influence de l’édition numérique, mais aussi de l’écriture numérique ?
La notion d’auteur, non. La notion d’écrivain, oui : terme inventé au XVIIe siècle, dans le contexte d’une spécialisation de la fonction et de ce qu’elle génère. Puis progressivement constitué dans une valeur fétiche ou symbolique au cours du XIXe siècle, à mesure de la progression marchande de la littérature. Évidemment qu’avec le web on remet les compteurs à zéro.
Je pense maintenant à l’art du mix, à l’appropriation, au partage… Pensez-vous que la notion d’auteur s’est modifiée avec les flux et le web 2.0 ? Autrement dit, ne pensez-vous pas qu’avec le réseau, l’écriture collective est devenue réalité ?
L’écriture collective n’a pas attendu le réseau pour devenir réalité, les exemples fourmillent, à commencer par l’aventure surréaliste. Ce qui est fascinant – et j’en parle plus en spectateur – c’est de voir s’inventer des expériences web qui autorisent des formes très neuves de réalisation collective, et que ce n’est pas du tout incompatible avec l’implication de fond, solitaire, de ceux qui y participent.
Pensez-vous que la littérature hypermédiatique soit de la littérature ? Ne pensez-vous pas que cette littérature souffre d’un déficit d’édition ? Pourquoi Publie.net ne s’est-il pas mis sur le coup ? Est-ce un problème économique ?
Il n’existe pas de prédicat “ceci est de la littérature”. C’est pour cela qu’il est nécessaire de constamment vérifier nos a priori. Ni Sévigné, ni Bossuet, ni Saint-Simon n’écrivaient pour la littérature. Elle est constamment une construction rétrospective. Par contre, je vous invite sérieusement à venir visiter Publie.net, l’iPad est un formidable outil d’invention pour les expériences “hypermédiatiques”, sauf que, justement, on n’a plus besoin de leur donner un nom barbare de cette sorte, on appelle ça “livre”, point barre.
Les écrivains ont toujours intégré leur médium (sans toujours le questionner). En France, des écrivains comme Mallarmé ou Apollinaire ont questionné la lettre et la page. Dans la littérature américaine, B.S. Johnson a troué son Albert Angelo, Douglas Coupland a joué avec les caractères et la pagination, Mark Danielewski a mis le livre sens dessus dessous, etc. De quelle manière l’édition électronique constitue-t-elle un nouveau médium à explorer pour les écrivains ?
Vous êtes un enfant devant un magasin de bonbons. Un monsieur très sérieux vient vous poser la question : de quelle manière un magasin de bonbons constitue-t-il un nouveau médium à explorer pour les enfants ?

François Bon à la médiathèque de Bagnolet, 2009. Photo: D.R.
Le théoricien de la littérature et des médias Friedrich Kittler écrivait en 1985 : la littérature, qui autrefois trônait sous le nom de poésie au-dessus de tous les médias, est maintenant définie par les autres médias. Qu’en pensez-vous ?
Rien à cirer. Baratin pour universitaire rémunéré en points de carrière à la publication. Si cette phrase est exacte, ainsi séparée de son contexte, ce type n’a pas dû lire grand-chose.
D’une manière générale, pensez-vous que les machines d’écriture et de lecture (imprimerie, presse, machines à écrire, PC, et maintenant les tablettes…) déterminent la manière dont on écrit ?
Non, c’est la tête, qui détermine. Et l’urgence. Et la notion de beau. Et la notion de notre propre expérience parmi les autres. Et notre passion dans la langue. Et ce qu’on y assemble.
Question subsidiaire. Vous faites partie de cette rare lignée des écrivains-éditeurs. Comment l’écrivain et l’éditeur vivent-ils ensemble ?
C’est le vieux monde qui détermine ces cloisons. Elles sont très récentes. Il y a des curseurs jamais simples à régler qui concernent, pour chacun, où qu’il soit, le rapport au travail et au temps personnel, les traversées de tunnel, y compris par rapport à des implications plus collectives. Pareil qu’on ne lit pas de la même façon selon qu’on est dans un chantier d’écriture ou pas, ou telle phase de ce chantier. J’ai monté avec quelques amis une coopérative d’édition numérique, parce qu’il nous fallait vitalement expérimenter, avoir notre propre lieu d’invention textuelle – y compris (mais pas seulement) à cause de l’inaction ou de l’hostilité frigide de nos propres éditeurs (ça a changé maintenant, ils sentent le gâteau). Mais ce n’est pas pour aller rejouer un modèle entrepreneurial, ou le paternalisme des maisons d’édition qu’on a connu, ni même les “modèles économiques” et autres conneries qu’on nous rebat. Écrire est intransitif, disait Maurice Blanchot, assumons cette intransivité-là où nous avons “déjà” notre territoire de lecture, écriture et expérience du monde : le web.
propos recueillis par Emmanuel Guez
publié dans MCD #66, “Machines d’Écritures”, mars-mai 2012
Photos: D.R.
> www.tierslivre.net







